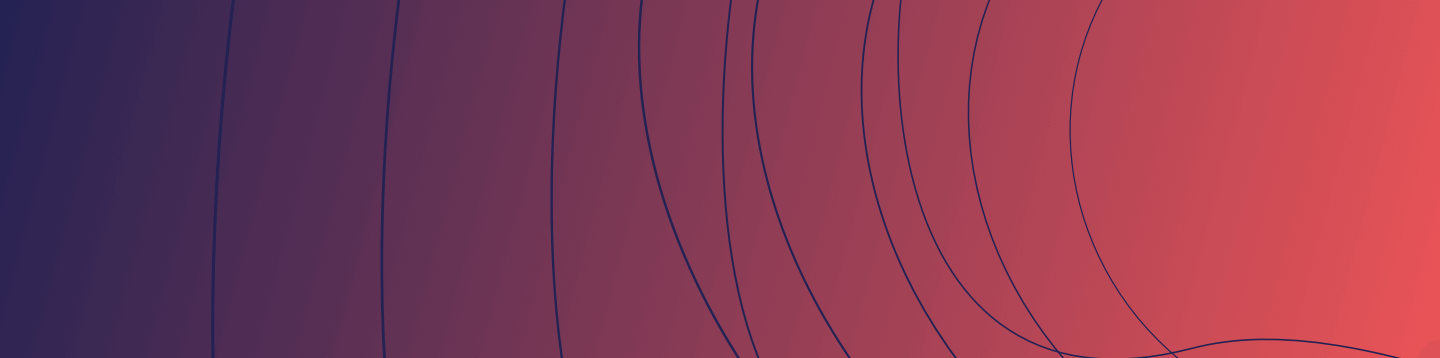INTRODUCTION
Le Président de l'ARCEP, Jean-Claude Mallet, n'a pas pu être devant vous aujourd'hui. Il vous prie de bien vouloir l'excuser.
La couverture numérique du territoire pour l'accès de tous aux réseaux les plus performants constitue l'une des principales priorités de l'Autorité et j'espère que cet exposé, par la variété des dispositions prises, vous en apportera la confirmation. Elle appelle un ensemble de dispositions, y compris une vraie stratégie de mutualisation de certaines infrastructures, et la poursuite d'une collaboration étroite avec les collectivités territoriales. Elle inclut la prise en compte des attentes du public comme des acteurs économiques en matière de qualité et de débit.
Le niveau de couverture n'est pas l'unique critère de l'aménagement numérique du territoire ; la progression de la concurrence sur les territoires en est aussi un indice significatif, dans la mesure où elle permet à une part de plus en plus importante de nos concitoyens de bénéficier de nouveaux services à des tarifs compétitifs. La concurrence incite par ailleurs les opérateurs à se différencier par de nouveaux services innovants ou par une couverture plus large : concurrence et couverture vont de pair.
I/ LE DEPLOIEMENT DU HAUT ET DU TRES HAUT DEBIT FIXE
1/ LE HAUT DEBIT FIXE
a/ LE HAUT DEBIT FIXE EN FRANCE : UN DEPLOIEMENT SIGNIFICATIF
La France bénéficie désormais d'un taux d'équipement parmi les plus élevés d'Europe pour l'accès à Internet haut débit, grâce à la mise en œuvre effective du dégroupage qui a permis la concurrence et l'innovation. Ainsi la France comptait au 30 septembre 2008 plus de 17 millions d'accès à Internet haut débit, dont plus de 8 millions ne disposent plus d'abonnement au service téléphonique traditionnel. Au total, le haut débit fixe par ADSL est aujourd'hui accessible à 98,3% de la population.
b/ LA COUVERTURE DES ZONES BLANCHES DU HAUT DEBIT
Le réseau téléphonique n'a pas été construit pour la fourniture d'Internet à haut débit. Environ 1,7% de la population (550 000 lignes) demeure inéligible à l'ADSL malgré l'équipement par France Télécom de l'ensemble des répartiteurs. La principale cause d'inéligibilité est la longueur excessive des lignes. Une minorité des zones blanches de l'ADSL sont couvertes par d'autres technologies.
Dans le cadre des compétences qu'elles se sont vues reconnaître par la loi en 2004, les collectivités territoriales se sont largement engagées dans la résorption de leurs zones blanches. Les collectivités qui se sont déjà engagées dans ce type de programmes ont permis de fournir un accès à environ la moitié de la population en zones blanches, sans compter les projets actuellement en préparation. Les projets de collectivités s'appuient principalement sur des solutions terrestres, qu'elles soient hertziennes (Wifi, Wimax) ou filaires (réaménagement du réseau téléphonique, NRA ZO).
En accompagnement de l'initiative des collectivités locales, le Gouvernement a annoncé l'objectif d'un accès au haut débit pour tous d'ici 2012. La solution consistant à recourir au mécanisme actuel du service universel n'a pas été retenue dans le cadre du plan « France numérique 2012 ». Ce dernier prévoit :
- Le principe d'une labellisation de la fourniture d'un service minimal du haut débit compatible avec la technologie satellite à un tarif abordable (moins de 35€ TTC par mois, équipement inclus). Un appel à manifestation d'intérêt vient d'être lancé à cet effet et plusieurs opérateurs ont fait des annonces. Il s'agit d'une solution de complément, destinée à couvrir les zones les plus isolées. La technologie satellitaire pourra en effet venir compléter utilement les déploiements terrestres, malgré ses limites actuelles, notamment en termes de capacités. Celles-ci pourront augmenter dans les années à venir dans la mesure où le débit visé doit désormais, compte-tenu de la demande, plutôt converger vers 2 Mbits/s.
- L'adoption de décrets permettant aux collectivités de disposer d'une meilleure information sur les réseaux déployés et les services disponibles sur leur territoire. Ils ont été publiés le 14 février.
L'Autorité est consciente des différences de perception entre les chiffres publics de couverture et la réalité vécue par les citoyens et les élus. Elle réfléchit aux moyens d'affiner encore l'analyse et d'encourager la résorption de ces situations.
c/ LA MONTEE EN DEBIT SUR LES TERRITOIRES
En outre, la question ne se limite plus à la résorption géographique des déficits de couverture. La demande concerne aussi le niveau des débits possibles. L'Autorité s'attachera en 2009 à favoriser la montée en débit des territoires, qui nécessite le déploiement de réseaux de collecte en fibre optique sans cesse plus proches des abonnés. L'Autorité a entendu la demande des collectivités territoriales de pouvoir accéder à la sous-boucle locale du réseau cuivre de France Télécom (au sous-répartiteur), alors que le dégroupage s'effectue aujourd'hui à la boucle locale (répartiteur). L'Autorité partage pleinement l'objectif de montée en débit recherché par les collectivités. Cette demande relève d'une démarche d'aménagement numérique durable à laquelle nous attachons la plus grande importance, et nous souhaitons apporter aux collectivités toute l'assistance et les outils nécessaires.
Il conviendra toutefois de tenir compte, dans cette démarche, de la situation dans laquelle se trouvent les principaux acteurs du haut débit. Au cours des dernières années, ils ont largement investi dans des équipements actifs installés dans les centraux téléphoniques et n'ont pas manifesté leur intention d'investir à la sous-boucle. Il est essentiel de veiller à ce que les modalités de mise en place du dégroupage à ce niveau ne viennent pas perturber l'économie du secteur par la remise en cause des investissements passés et l'introduction d'un degré de complexité supplémentaire dont pourraient également pâtir les utilisateurs.
Enfin, les objectifs de montée en débit peuvent correspondre à des besoins différents selon les collectivités. Dans un certain nombre de cas, les débits insuffisants résultent de configurations ponctuellement défavorables du réseau téléphonique, notamment en périphérie des zones urbaines. Par ailleurs, la question de la montée en débit se pose plus globalement sur les territoires moins denses. Ces deux situations peuvent appeler des réponses différentes.
Plus concrètement, les dispositions suivantes ont été prises :
- Les services de l'Arcep ont identifié plusieurs options pour mettre en place l'accès à la sous-boucle, parmi lesquelles : l'installation d'équipements au niveau des sous-répartiteurs dans l'état actuel du réseau ; le réaménagement du réseau téléphonique par la création de répartiteurs haut débit au niveau des sous-répartiteurs actuels ; l'installation de solutions de déport des signaux haut débit entre les sous-répartiteurs et les répartiteurs.
L'Autorité a demandé à France Télécom d'évaluer ces différentes options sur les plans technique et opérationnel, et de conduire les expérimentations nécessaires avec les opérateurs intéressés. Ces travaux associeront l'ensemble des acteurs.
- Conformément à l'engagement pris par l'ARCEP lors du CRIP du 17 septembre 2008, des représentants d'associations de collectivités locales participent désormais aux travaux du Comité d'experts de la boucle locale.
- En termes de calendrier, ces travaux devront permettre à l'été 2009 de définir les conditions de mise en œuvre de l'accès à la sous-boucle. Un point d'étape sera effectué dans le courant du mois d'avril.
2/ LE TRES HAUT DEBIT FIXE :
La demande sans cesse croissante des usagers en débits appelle inéluctablement le rapprochement de la fibre des abonnés. La fibre a vocation à devenir une infrastructure équivalente à celle du réseau électrique ou téléphonique.
Le calendrier 2009 de l'ARCEP est clair et exigeant pour ce dossier majeur. Les opérateurs ont lancé les expérimentations qui permettront de disposer de premiers retours d'expérience au 31 mars. Sur cette base, l'Autorité adoptera d'ici le milieu de l'année un premier dispositif réglementaire venant préciser les règles applicables à la mutualisation de la partie terminale dont le principe a été posé dans la loi de modernisation de l'économie (LME). Ce dispositif doit favoriser le passage à la phase opérationnelle du déploiement de la fibre optique. Il sera évolutif pour s'adapter aux différentes conditions de déploiement en fonction de la densité variable des territoires.
L'Autorité s'attache déjà à ce que les opérateurs aient un égal accès au génie civil de l'opérateur historique, qui constitue une infrastructure essentielle au déploiement de la fibre. France Télécom a publié une première offre de fourreaux au 15 septembre 2008, qui est appelée à évoluer pour permettre des déploiements plus importants. La mise à disposition de ces capacités dans des conditions transparentes, équitables et efficaces fait l'objet de vérifications sur le terrain par les services de l'ARCEP.
Notre objectif est que les opérateurs disposent dès le milieu de l'année d'un cadre clair, permettant à tous les opérateurs d'investir dans la fibre.
Les collectivités peuvent intervenir à plusieurs niveaux pour favoriser la couverture des territoires par les réseaux fibre :
- En amont du déploiement, elles peuvent mettre des fourreaux à la disposition des opérateurs, mais également réaliser des études et engager des discussions avec les opérateurs sur la localisation et le dimensionnement du point de mutualisation afin d'éviter autant que possible une couverture morcelée sur une zone.
- En tant que gestionnaire du domaine public, elles sont directement intéressées à la localisation et à l'hébergement du point de mutualisation, par exemple dans des armoires de rue.
- Lorsqu'elles souhaiteront investir dans le déploiement d'un réseau FTTH, elles devront appliquer le principe législatif de la mutualisation de la partie terminale des réseaux. Des discussions préalables avec les opérateurs seront donc nécessaires pour définir les conditions techniques et tarifaires de cette mutualisation.
Pour accompagner les collectivités, l'Autorité va conduire des travaux en 2009 sur l'ensemble de ces questions dans le cadre du comité des réseaux d'initiative publique.
3/ L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Depuis 2004, les collectivités territoriales ont acquis avec l'article L. 1425-1 du CGCT une véritable compétence pour intervenir en tant qu'opérateurs de réseaux et en cas d'insuffisance d'initiatives privées, opérateurs de services aux clients finals. En l'absence de rentabilité, elles peuvent subventionner ces activités.
Les projets d'initiative publique mis en œuvre dans ce cadre sont également soumis au régime communautaire des aides d'Etat, qui a pour objet d'encadrer l'intervention des autorités publiques dans le secteur marchand. Cette jurisprudence a tracé les contours des interventions possibles au regard de l'impact des financements publics sur la concurrence.
En quatre ans, les collectivités ont engagé 85 projets structurants couvrant chacun plus de 60 000 habitants, pour un investissement cumulé de 1,4 milliard d'euros et plus de 20 000 Km de réseau fibre.
Les réseaux d'initiative publique (RIP) s'inscrivent dans une double logique d'aménagement du territoire et de développement de la concurrence. Les projets des collectivités en matière de couverture de zones blanches sont pour la plupart structurés autour de nouveaux réseaux de collecte. Ces derniers permettent d'irriguer les territoires en fibre optique (plus de 2000 zones d'activité sont desservies en fibre optique grâce aux RIP) et favorisent le dégroupage (40% des NRA dégroupés grâce aux RIP).
L'ARCEP anime depuis 2004 le CRIP qui rassemble les collectivités territoriales qui le souhaitent, les opérateurs, la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité du territoire (DIACT), les ministères concernées (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDAT), Secrétariats d'Etat chargés des communications électroniques et du développement de l'économie numérique) et la Caisse des Dépôts. Le Comité publie des documents d'orientation et des guides pratiques qui ont pour vocation à recenser les bonnes pratiques et à faciliter la recherche de synergies entre initiatives publiques et investissements privés.
Plusieurs axes de travail ont été définis au sein du CRIP pour 2009 :
- Couverture des zones blanches du haut débit ;
- Montée en débit sur les territoires afin d'améliorer la disponibilité des services, notamment par le biais du dégroupage de la sous-boucle locale ;
- Contribution des collectivités au déploiement des réseaux de fibre optique, notamment par la mise à disposition d'infrastructures de génie civil et par l'amélioration des conditions de mutualisation ;
- Accompagnement de la mise en œuvre des décrets prévus dans la LME pour permettre aux collectivités de disposer d'une meilleure information sur les réseaux déployés et les services disponibles sur leur territoire.
II/ LA COUVERTURE MOBILE
1/ LA COUVERTURE GSM
a/ 99% DE LA POPULATION EST COUVERTE EN GSM
Suite à leur renouvellement en 2006, les licences GSM d'Orange France et SFR imposent aux opérateurs un taux de couverture minimum de 99% de la population, incluant la couverture des zones blanches dans le cadre du programme décrit ci-dessous. Les obligations de Bouygues Télécom seront portées au même niveau que celle des autres opérateurs au terme de la procédure de renouvellement de sa licence d'ici fin 2009.
Chaque opérateur déclare couvrir aujourd'hui environ 99% de la population.
b/ LES OPERATEURS DOIVENT ACHEVER LE PROGRAMME « ZONES BLANCHES »
Au-delà de ces déploiements, le programme « Zones blanches » a été mis en place par le Gouvernement, l'ARCEP, les collectivités locales (ADF et AMF) et les opérateurs mobiles, afin d'apporter la couverture mobile dans 2949 communes de métropole où aucun des trois opérateurs n'était présent en 2003. Ce programme permet à chaque opérateur d'atteindre le taux de 99% précité.. Le taux de couverture de la population par au moins un opérateur mobile dépassera quant à lui 99,3 % au terme du programme.
Ce programme, dont la phase 1 est basée partiellement sur des financements publics, et dont la phase 2 est, conformément aux licences, entièrement à la charge des opérateurs est en cours d'achèvement ; il reste 113 communes à couvrir, selon le Secrétariat d'Etat à l'Aménagement du Territoire.
De plus, après un recensement effectué localement sous l'égide des Préfets en début d'année 2008, il est apparu que 364 communes non couvertes avaient échappé au recensement initial fait en 2003. Il a donc été décidé d'étendre le programme « Zones blanches » initial à ces communes. Au total 477 communes restent non couvertes, elles devraient l'être d'ici le début de la prochaine décennie.
Il est enfin utile de rappeler qu'en dehors du programme « zones blanches mobiles », les collectivités territoriales ne sont pas intervenues dans le déploiement des réseaux mobiles en application de l'article L. 1425-1. Cette situation est due pour l'essentiel à la nécessité d'obtenir une autorisation nationale d'utilisation de fréquences pour le déploiement de tels réseaux, ce qui n'est pas le cas pour le fixe.
c/ LES OPERATEURS DOIVENT COUVRIR LES AXES DE TRANSPORT PRIORITAIRES
Conformément à la loi et à leurs licences, les opérateurs mobiles ont également l'obligation de couvrir spécifiquement les axes de transport prioritaires, notamment les axes routiers principaux de chaque département métropolitain. Ces axes ont été définis dans l'accord national pour la couverture des axes de transport prioritaires en téléphonie mobile, signé sous l'égide du Ministre chargé de l'aménagement du territoire en février 2007 : ils représentent les routes où au moins 5 000 véhicules circulent en moyenne par jour ainsi que les axes reliant les préfectures aux sous-préfectures dans chaque département. Les opérateurs doivent achever leur couverture d'ici la fin de la décennie.
d/ UN BILAN GLOBAL DE LA COUVERTURE 2G SERA REALISE PAR L'ARCEP A L'ETE 2009 EN COMPLEMENT DES CARTES PUBLIEES PAR LES OPERATEURS
L'ARCEP a adopté en 2007 des dispositions visant à augmenter la transparence et l'information des consommateurs sur la couverture. Une méthodologie harmonisée de publication par les opérateurs de cartes de couverture a ainsi été définie, comprenant des vérifications de ces cartes par des enquêtes de terrain annuelles. Ces cartes sont publiées par les opérateurs depuis octobre 2007 et les premières enquêtes de vérification des cartes de couvertures publiées par les opérateurs ont été menées durant l'année 2007. Il ressort de ces enquêtes que les cartes publiées sont fiables et cohérentes avec les mesures terrains à hauteur de 95%
De plus l'article 109-IV de la LME prévoit que, tous les ans avant le 31 janvier, chaque opérateur mobile de deuxième génération rende publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'ARCEP la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours.
Comme prévu par l'article 109-V de la LME, un bilan global de la couverture du territoire, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs mobiles 2G (zones grises), sera fait par l'ARCEP d'ici août 2009.
e/ ENQUÊTES DE QUALITÉ DE SERVICE
Chaque année, l'ARCEP conduit une enquête concernant la qualité des services de voix et des services de données (SMS, MMS, services WAP, visiophonie et tests de débits) sur le réseau des trois opérateurs métropolitains.
Le périmètre géographique de l'enquête du service voix est celui des agglomérations de plus de 20 000 habitants et le périmètre géographique de l'enquête des services de données est celui des 12 agglomérations les plus peuplées.
Les résultats des enquêtes menées en 2008 montrent que :
- les débits des réseaux mobiles ont doublé en un an et sont comparables aux débits offerts par l'ADSL d'entrée de gamme.
- La qualité des autres services est toujours très satisfaisante (à 98% pour la voix).
Cependant, compte tenu des différences de perception entre ces chiffres et les informations qui nous remontent par ailleurs des élus et du public, et afin d'enrichir les mesures, l'Autorité a décidé, en accord avec les opérateurs, de tester dès cette année des appels plus longs et réalisés pour partie dans des communes de moins de 20 000 habitants.
2/ LA COUVERTURE DES RESEAUX 3G
a/ PROCHAINES ECHEANCES DE DEPLOIEMENT : AOUT 2009 POUR ORANGE ET SFR ET DECEMBRE 2010 POUR BOUYGUES TELECOM
Alors que l'UMTS a désormais pris son essor avec plus de 10 millions de clients actifs, les opérateurs ont toutes les cartes en main pour atteindre leurs engagements de déploiement. Afin de faciliter la couverture du territoire en UMTS, l'ARCEP a autorisé les opérateurs 3G à réutiliser pour l'UMTS leurs fréquences basses de la bande 900 MHz. Le principe de cette réutilisation était prévu depuis 2000 dans les appels à candidatures 3G. Au début de l'année 2008, l'ARCEP a donc modifié les autorisations d'Orange France et SFR pour leur permettre de déployer la technologie UMTS dans les fréquences basses de la bande 900 MHz. Bouygues Telecom s'est vu proposer la même possibilité, mais l'opérateur, qui conteste devant le juge les conditions de réattribution de sa licence, n'a pas, à ce jour, formulé de demande en ce sens. Quoiqu'il en soit, cette faculté, que la France est l'un des premiers pays en Europe à mettre en œuvre, devrait donner un nouvel élan aux efforts de couverture du territoire, en raison des caractéristiques très favorables de propagation des fréquences concernées.
Dans ces conditions, les opérateurs doivent honorer les obligations de déploiement figurant dans leur licence 3G.
A cet égard l'ARCEP sera particulièrement attentive à la troisième échéance en matière d'engagements de couverture de SFR et Orange France, qui interviendra le 21 août 2009. Ces engagements prévoient une couverture de respectivement 99,3% et 98% de la population, soit un niveau comparable à celui de la 2G. Ces engagements ont été pris par les opérateurs d'eux-mêmes lors de l'attribution des licences, au delà des obligations minimales prévues par l'appel à candidatures. La prochaine échéance de couverture prévue dans la licence 3G de Bouygues Telecom interviendra en décembre 2010 et correspondra à 75% de la population.
b/ L'ARCEP DOIT PRENDRE UNE DECISION AU PREMIER TRIMESTRE 2009 EN MATIERE DE PARTAGE D'INSTALLATIONS 3G
L'article 119 de la LME demande à l'ARCEP de déterminer, après consultation publique, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, afin de faciliter la progression de la couverture 3G.
Conformément à la loi, l'ARCEP a lancé en décembre 2008 une consultation publique sur le sujet du partage d'installations de réseau de troisième génération. Les contributions à cette consultation publique sont en cours de dépouillement par l'ARCEP. La synthèse sera rendue publique très prochainement. Le partage d'installations de réseau est une possibilité ouverte depuis longtemps aux opérateurs, mais le contexte et le rendez-vous fixé par la loi confèrent une actualité nouvelle à cette approche.
c/ LA 4EME LICENCE NE FREINERA PAS LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
- Les opérateurs existants ont des obligations de couverture dans leurs licences 3G et doivent les honorer. Pour eux, l'enjeu relatif à la couverture 3G n'a donc pas de lien avec le prochain appel à candidatures.
- Les obligations minimales de couverture du nouvel entrant seront identiques à celles prévues par les précédents appels à candidature (au bout de 2 ans : 20% de la population pour les données et 25% pour la voix ; au bout de 8 ans : 60% pour les données et 80% pour la voix).
- Le fait que la 4ème entrant ne dispose que de 5 MHz dans la bande 2,1 GHz ne crée pas de difficultés au regard de la couverture, car c'est le couplage avec la bande 900 Mhz qui lui permettra d'assurer la couverture du territoire ; la quantité de fréquences n'est un enjeu que dans les zones denses, où il y a besoin d'écouler un trafic important.
- Par ailleurs, l'arrivée d'un 4ème opérateur sera de nature à stimuler et accélérer l'investissement dans l'extension de la couverture par les opérateurs mobiles existants, dans la mesure où la couverture est un levier crucial de différenciation commerciale.
3/ COUVERTURE EN TRES HAUT DEBIT MOBILE
Le développement des services mobiles connaît une profonde mutation, caractérisée par une migration accélérée vers l'accès à haut et très haut débit. Ces services devront être disponibles partout et à tout moment avec le même confort d'utilisation et la même richesse d'usages que les accès filaires performants.
Les technologies mobiles permettant de fournir des performances en adéquation avec les attentes du marché sont en cours de développement. Il s'agit notamment de la technologie dite LTE « Long Terme Evolution ».
Elles devraient offrir aux utilisateurs des débits d'une à plusieurs dizaines de Mbits/s, largement supérieurs aux performances des technologies 3G et 3G+ actuellement déployées.
Elles vont nécessiter des fréquences supplémentaires. Les bandes de fréquences additionnelles identifiées pour le très haut débit mobile sont d'une part la bande 2500 – 2690 MHz (dite bande 2.6 GHz) ; et d'autre part des fréquences du dividende numérique : la bande 790-862 Mhz (dite bande 800 MHz)
La bande de fréquences hautes à 2,6 GHz permettra, grâce à la grande quantité de fréquences qu'elle comporte, de déployer des réseaux mobiles offrant des performances nettement supérieures aux réseaux 3G actuels. Toutefois, elle présente des conditions de propagation qui limitent son utilisation aux zones denses en population.
En complément, des fréquences basses, c'est-à-dire inférieures à 1GHz, sont indispensables pour assurer la couverture étendue du territoire en très haut débit mobile lors de la prochaine décennie.
Le Premier ministre a approuvé, par arrêté du 22 décembre 2008, le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion de la télévision analogique qui prévoit d'affecter la sous-bande 790-862 MHz aux services mobiles de communications électroniques.
A l'occasion de l'annonce de la stratégie globale pour le numérique en France, le 12 janvier dernier, le Premier ministre a demandé à l'ARCEP de lancer d'ici la fin de l'année un appel à candidatures conjoint à la fois dans la sous-bande du dividende numérique et la bande 2,6 GHz. Dans cette perspective l'ARCEP va lancer une vaste consultation publique fin février-début mars. Elle tiendra aussi, sur ces sujets majeurs, des auditions publiques.
CONCLUSION
Au delà des distinctions technologiques (fixe/mobile ; filaire/hertzien) qui prévalent encore largement aujourd'hui, on distingue des évolutions communes vers une progression très sensible des débits offerts sur les réseaux de communications électroniques.
Ces évolutions vont permettre de fournir des services toujours plus nombreux et de meilleure qualité aux utilisateurs finaux et contribuer à l'aménagement et à la couverture du territoire en multipliant les canaux de diffusion des services pour l'ensemble des citoyens.
Elles apporteront aussi une continuité et une convergence entre les services consultés à la maison ou au bureau et les services utilisés en mobilité. En ce sens, il y aura à terme une réelle complémentarité des déploiements de réseaux, entre la fibre et le très haut débit mobile par exemple, pour apporter à tous des services de qualité équivalente à un prix abordable.
Cette complémentarité entre réseaux fixes et mobiles permettra la couverture des territoires en haut et très haut débit. C'est notamment la raison pour laquelle le Gouvernement et l'Autorité ont souhaité progresser sur ces deux chantiers en 2009 (à travers d'une part la poursuite des travaux sur la fibre optique et d'autre part le lancement d'une vaste consultation publique sur le très haut débit mobile).
Enfin, dans la poursuite de ses missions, l'Autorité doit veiller à un équilibre permanent entre les principaux objectifs qui lui sont assignés par la loi, et plus particulièrement :
- L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
- Le développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- La prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs.
Je vous remercie.