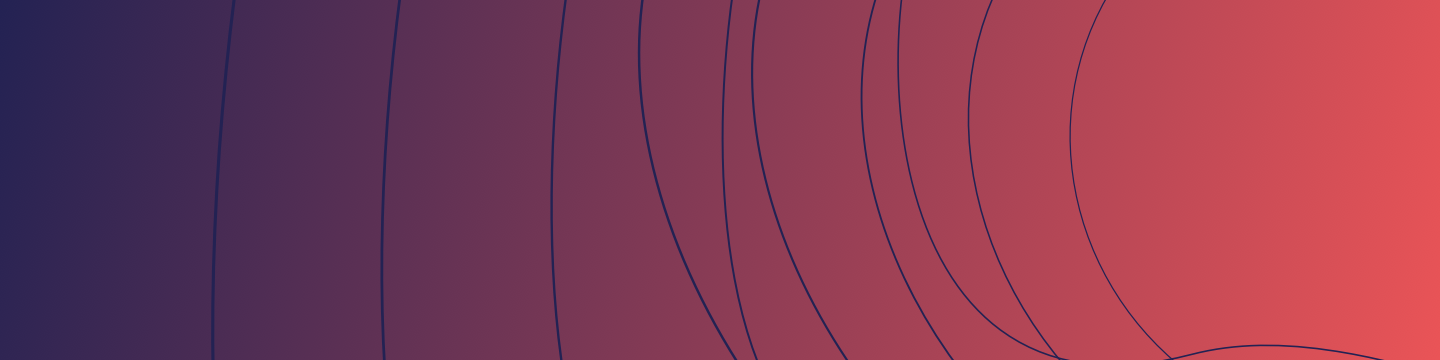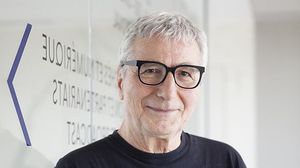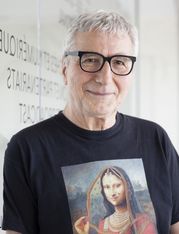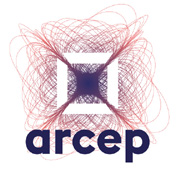« Partir d’un tableur de 2 lignes et 2 colonnes, et inventer la régulation »
Laure m’a demandé, au moment où je quitte l’Arcep, de témoigner, moi qui ai connu sa création (elle était alors l’ART) et, auparavant, participé à la préparation de l’ouverture à la concurrence. C’est forcément une vision personnelle, partielle et partiale et je connais quelques personnes qui seraient tout autant légitimes à le faire et bien mieux que moi.
L’ART a été créée sous de bons auspices : une LRT (Loi de Régulation des Télécommunications) bien conçue, veillant sur le plan politique à concilier ouverture complète à la concurrence et préservation du service universel et articulant dès le départ l’action de l’ART avec celle de l’alors Conseil de la concurrence.
Sur le plan des principes économiques, un groupe de haut niveau présidé par Paul Champsaur avait été monté en 1996. Il comprenait des économistes renommés, comme Jean-Jacques Laffont, et des experts internationaux. Il avait permis de clarifier les concepts, encore flous à l’époque, qui faisaient parallèlement l’objet d’intenses débats avec le secteur dans le cadre de réunions multilatérales, notamment sur la tarification de l’interconnexion et les coûts associés. Il a aussi su relever la nette distinction qu’il fallait faire entre financement du service universel et rémunération de la prestation d’interconnexion.
Dans ce cadre, la feuille de route de l’ART début 1997 était simple : préparer l’ouverture à la concurrence du 1er janvier 1998, notamment en approuvant le « catalogue d’interconnexion » au réseau téléphonique de France Télécom. Il s’agissait alors, contrairement au dispositif régissant maintenant les « offres de référence », d’une approbation préalable des conditions techniques et tarifaires, nécessairement « orientées vers les coûts ». Une circonstance a considérablement aidé alors l’ART : la demande d’arbitrage formulée en 1995 par l’opérateur mobile SFR sur ses conditions d’accès au réseau fixe de France Télécom.
Suite de l'article du Post 76...
Dans des conditions qui feraient frémir aujourd’hui nos juristes, cet arbitrage a été rendu en 3 mois : partant d’un tableau sommaire de deux lignes et deux colonnes relatif aux coûts et aux revenus des communications téléphoniques d’une part et des lignes téléphoniques d’autre part, obtenu unilatéralement de France Télécom, il a permis de réduire très significativement la facture de SFR. Cela a convaincu France Télécom d’accepter ex post un audit des comptes du réseau général[1] dans un format qui préfigurait les comptes réglementaires tels qu’ils se sont développés depuis. Ses résultats ont permis à l’ART de disposer d’une base rationnelle pour approuver les conditions d’interconnexion de 1998, ce qui a été fait dès avril 1997.
Ça a été une époque de défrichage avec des équipes réduites mais motivées sous l’autorité du 1er directeur général de l’ART, Pierre-Alain Jeanneney, qui a structuré le mode de fonctionnement de l’institution. Je n’oublie pas Jean-Michel Hubert, 1er président de l’ART dont je dirai qu’il a été un président courageux. Il s’est vite montré, avec son collège d’alors, pugnace et déterminé face à des pressions et des oppositions qui n’ont pas manqué vis-à-vis de cette jeune institution. Je me rappelle aussi avec une certaine émotion de la 1ère directrice juridique de l’ART, Bettina Medioni, morte prématurément, mais qui m’avait marqué : elle était une juriste de combat et de conviction.
De son côté Philippe Distler, qui est devenu par la suite un fameux directeur général de l’Arcep, était à l’œuvre sur la numérotation puis rapidement sur les prestations d’interconnexion et de dégroupage, et nous formions un attelage, l’un faisant monter au catalogue d’interconnexion de nouvelles prestations et l’autre en en contrôlant les tarifs. Cette dichotomie a pris fin quand nous sommes passés quelques années plus tard à une organisation par marché mais elle subsiste encore en partie aujourd’hui.
Il y a eu aussi dès cette époque un dosage subtil entre négociation à froid avec France Télécom (et plus tard les opérateurs mobiles) et règlements de différend, quelquefois suscités, seuls à même de débloquer certaines situations. Aujourd’hui encore, on se retrouve avec cette sorte de dilemme : faut-il fixer de manière proactive certaines conditions d’accès pour apporter de la visibilité aux acteurs et réduire les coûts de négociation entre eux mais avec un risque juridique et celui de le faire de manière non optimale ou faut-il laisser faire et n’intervenir que de manière circonscrite avec les risques d’une forme de désordre ? Il y a bien sûr des formules intermédiaires.
Dans ces premières années de l’ART, deux dossiers m’ont marqué.
Les tarifs de terminaison d’appel des opérateurs mobiles, sujet obsolète mais qui illustre la palette des différentes formes d’intervention du régulateur. Les tarifs des communications depuis le fixe à destination des mobiles étaient à cette époque particulièrement élevés et c’était un problème sensible pour les consommateurs. Face à cette situation l’ART a d’abord cherché un accord avec les opérateurs mobile à travers une « table ronde », qui a eu un succès mitigé. L’année suivante, un règlement de différend initié par un opérateur fixe a abouti à une baisse plus sensible mais ponctuelle. A l’issue, les opérateurs mobiles ont été convaincus de s’engager sur un reporting de leurs coûts en s’inspirant de celui établi pour le fixe, pour éviter l’aléa de règlements de différend. L’Arcep a pu ainsi disposer d’une base solide pour fixer un train de baisses significatives sur trois ans. Ces reportings annuels ont perduré assez longtemps et ont été bien utiles à Benoît Loutrel quand il a repris avec la vigueur qu’on lui connaît cette régulation dans le cadre de l’analyse des marchés.
Le dégroupage a été un chantier d’une toute autre ampleur et de de longue haleine et il serait difficile d’en relater ici toutes les péripéties, dont Philippe Distler et Cécile Dubarry se souviennent. Il a été ponctué de nombreux conflits et l’ART a du faire preuve d’agilité et de ténacité pour en assurer la viabilité avec finalement le succès que l’on sait. Les enjeux étaient importants : il s’agissait de passer d’une concurrence étroite et condamnée à terme, celle portant sur les seules communications téléphoniques, à un modèle plus large intégrant l’accès et correspondant peu ou prou à la situation que nous connaissons actuellement.
Agilité, rationalité et ténacité, telles pourraient être les qualités révélées derrière l’acronyme « ART ». Aujourd’hui que l’Arcep a vu ses missions historiques considérablement étendues et étoffées, je ne doute pas qu’elles lui assureront encore de nombreux succès.
François Lions, membre du collège de l’Arcep
► Le Post n° 76 - Janvier / Février 2025